Visions Épisode 2 : Les savoir-faire : matière précieuse de l’innovation Le - Première Vision Paris - Denim Première Vision - Première Vision New York
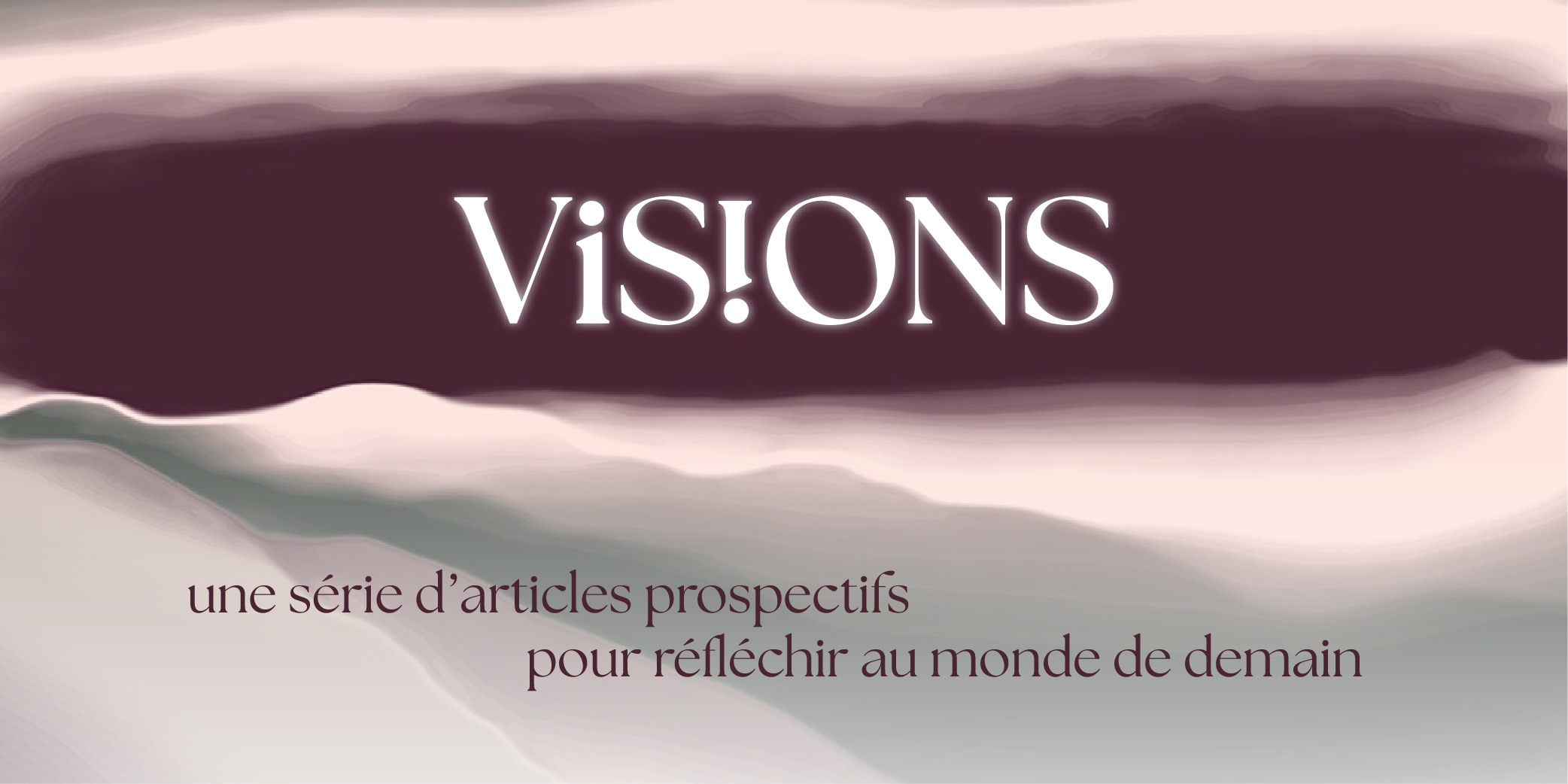
Visions est une série d’articles prospectifs, pour réfléchir au monde de demain – ses contours, ses modèles, ses enjeux. À travers le regard d’intervenants spécialisés dans des domaines variés, la série Visions entreprend une observation de nos sociétés, en multipliant les angles de vue, pour tâcher de répondre à différentes questions : Comment peut-on, aujourd’hui, commencer à entrevoir demain ? À quels grands courants ou signaux faibles être attentifs, pour percevoir et anticiper les modèles à venir, les nouvelles manières de vivre, de créer, de produire, de consommer ? En recueillant les observations, analyses et visions prospectives issues de domaines allant de la création multidisciplinaire à l’économie en passant par l’éco-responsabilité ou les nouvelles technologies, Première Vision souhaite informer, stimuler et délivrer des clefs aux acteurs de la filière mode.
Les savoir-faire passionnent. Indissociables de la création, ils sont au cœur de l’écosystème de la mode. Première Vision leur accorde la primeur de l’édition de février. Dans le luxe, où ils sont un gage d’excellence et qui n’a de cesse de les protéger, ils séduisent de plus en plus le grand public. En s’intéressant davantage à la matière, les consommateurs sont avides de faire. Le Do It Yourself, qui traduit sur les réseaux sociaux cet engouement pour l’artisanal ne se cantonne plus à de petits ateliers de tricot mais s’étend à la céramique, la broderie.
Pour montrer l’étendue de cette culture de la main, Sandrine Pannetier, qui a dirigé pendant 15 ans le bureau de prospective et création Leherpeur Paris, devenue indépendante, a réalisé une étude sous forme de « Grand Inventaire du Craft et des Savoir-faire textile ». Partant d’un état des lieux fouillé de tous ces savoir-faire existants, elle montre la transformation de ce faisceau de signaux faibles en signaux forts. Elle met en évidence l’étendue des champs d’observation de cette culture du craft et de la main en pleine effervescence.

Les marqueurs nombreux de l’intérêt pour les savoir-faire
Les marques de luxe n’ont eu de cesse de soutenir l’excellence de leurs façonniers. Les Maisons ont un rôle de prescription très fort dans ce surcroit de visibilité. Sandrine Pannetier cite plusieurs marqueurs de cet investissement des Maisons :
« La récente nomination de Matthieu Blazy à la tête de la Maison Chanel, en remplacement de Virginie Viard, va dans ce sens, lui qui dans sa précédente maison, Bottega Veneta, a pris soin de protéger cette technique du cuir tressé, qui fait la signature de la griffe tout en y injectant de l’innovation. Chanel et le groupe LVMH, à travers la création de leurs temples de la Main, le 19M et La Main-LVMH Métiers d’art, ont également œuvré à une plus grande visibilité des gestes et des techniques. Les maisons organisent des défilés dédiés, les musées de grandes expositions à l’instar du Grand Palais avec l’exposition Du Cœur à la Main, autour de la créativité et du savoir-faire de la maison italienne Dolce & Gabbana. Des prix sont attribués qui viennent récompenser la façon, à l’image du Craft Prize de LOEWE FOUNDATION dans le luxe, et du prix Craft de la marque Sessùn ».

L’art contemporain, que l’on peut voir comme une antichambre des tendances du futur, est un autre observatoire de choix : ce n’est pas un hasard si ce Craft Prize dont nous venons de parler est exposé au Palais de Tokyo. L’autrice de l’étude cite des artistes comme « Chloé Bensahel et Cathryn Boch lesquelles suscitent un vif intérêt ; Olga de Amaral, triomphe avec son exposition à la Fondation Cartier. Enfin, les craftartists et fiberartists s’invitent en nombre à la dernière Biennale de Venise ». Cet engouement se retrouve parallèlement sur les réseaux sociaux, incarné par des artistes et une nouvelle génération de galeries : Ameliemaison d’art avec Sandrine Torredemer, ou encore la galerie Baró avec Sylvia Sanchez Montoya.
Du côté des métiers, les profils s’hybrident. Dans la grande famille de ceux que Sandrine Pannetier surnomme les « pratiquants », les frontières se floutent entre artistes, artisans d’art, designers et industriels résiliants, manufactures.
On retrouve, dans l’histoire, de tels cycles porteurs pour l’artisanat. Ils coïncident souvent avec des périodes de crise.
« On observe sur le long terme, nous dit l’historien et sociologue Hugues Jaquet, qu’à chaque fois que des crises se présentent, qu’elles soient sociales, économiques ou environnementales – à la fin du XIXe siècle, durant l’entre-deux-guerres ou lors du choc pétrolier – l’artisanat refait surface en réponse à ces réalités. Comme si la société réactivait ces valeurs parce qu’elles sont porteuses de savoir-vivre et de savoir-être ensemble ».
Sandrine Pannetier
Sandrine Pannetier, qui a étudié dans le détail cet écosystème, souligne le paradoxe que « cette hausse de l’intérêt s’accompagne dans le même temps d’une baisse de la culture textile ». Elle semble assez générale, les enseignants la constatent, et même certains professionnels. La délocalisation de la production, l’éclatement de la chaîne de valeur sur plusieurs milliers de kilomètres est pour beaucoup dans cette perte de connaissances.
Prise de conscience de la course au « sur » (sur-production, sur-consommation…)
Ainsi, c’est en prenant conscience des effets de la mondialisation et de la sur-industrialisation que l’intérêt pour les savoir-faire a resurgi. Il raconte en creux comment notre société est en train de prendre conscience des conséquences des excès.
Le manuel, le temps long, l’exigence des matières et de la façon importent d’autant plus que l’on a laissé en France la production s’envoler loin de nos yeux, à des milliers de kilomètres, dans le but d’augmenter les marges, baisser les coûts. Le système de l’ultra-fast-fashion en est le symptôme le plus visible. Mais derrière, c’est la perte des machines, des métiers, des techniques, que depuis le Covid notamment, on tente de compenser.
Des consommateurs plus curieux
C’est dans ce contexte que sont apparus de nouveaux modes de vie qui questionnent le « comment », depuis la matière jusqu’au produit fini. Un phénomène très semblable à celui qui s’était produit dans l’alimentation conduit à valoriser le local, à développer une culture du territoire, en donnant la primeur aux petites échelles, aux circuits courts. Un vent d’engagement s’est fait sentir dans tout l’écosystème qui a emporté de nombreux acteurs de la chaîne de valeur depuis les agriculteurs et producteurs, les éleveurs, les petits industriels, les créateurs, les fabricants. On voit se développer par exemple un intérêt croissant pour les fibres naturelles (lin, chanvre, laine), qui témoigne d’un nouveau rapport à la nature et au travail minutieux de la main. L’attention se porte de plus en plus sur la transparence, depuis la récolte des graines jusqu’à la confection. Des développements intéressants et prometteurs se font, qui mêlent innovation et tradition.

Des relais créatifs et militants
Cet intérêt soutenu du grand public pour les savoir-faire et la traçabilité des articles de mode coïncide également avec un plus fort engagement des acteurs de la mode, comme ceux que l’on pourrait qualifier d’« activistes ».
« La pression positive qu’exercent des médias comme The Good Goods de Victoire Satto, ou l’association Loom permet de documenter ces sujets. Ils jouent aussi le rôle d’incarnation dans des conférences et sur le terrain économique et politique ».
Sandrine Pannetier
Derrière cette plus grande médiatisation de ces sujets, il y a ces personnes, ces médias, il y a aussi des fédérations à l’instar de la Fédération de la mode circulaire. On ne peut plus parler concernant l’engagement de ces acteurs en termes de signaux faibles mais forts. Ils incarnent et fédèrent cette envie montante de construire un « comment » différent.
De nouveaux acteurs et de nouveaux registres

Cette envie de construire un projet différent est manifeste dans toute l’industrie. Elle est portée par une nouvelle génération de ce que Sandrine Pannetier appelle les « labartisans », qui travaillent main dans la main avec des chercheurs. Ils nous donnent une idée de ce que pourrait être la production dans le futur. À l’opposé du syndrome de Gepetto, fort bien décrit par Grégoire Talon, lequel associe les savoir-faire à une image romantique de l’artisan, travaillant seul dans son atelier baigné par une lumière jaune tamisée. Ces nouveaux acteurs, designers/chercheurs, start-up ou industriels, à l’image de Tony Jouanneau (procédés de teinture avec des micro-algues), Eastman, Superlativa (qui transforme les restes de l’industrie perlière), ou encore Spiber qui passe le cap de la production industrielle pour sa fibre protéique obtenue par fermentation de biomasses) se saisissent de la 3D, de la découpe au laser, de l’intelligence artificielle, du biomimétisme et de la microbiologie. Ce sont eux qui nous ouvrent la porte de ce que pourrait être une des voies du système de demain.
De même, une génération d’entrepreneurs, certains incubés à l’IFM, innove dans l’utilisation des matières. Les jeunes femmes ne sont pas en reste. Elles sont plus proches de la nature. En réaction à la multiplication des alertes sur la toxicité de certains vêtements, Imane Do Vale a lancé la marque de lingerie Nissé, laquelle propose des modèles en matières vertueuses comme la fibre de ricin. Lora Sonney, créatrice éponyme de la marque Lora Sonney, remarquée au Festival de Hyères et gagnante du prix de l’entrepreneuriat Ami x IFM, a créé son matériau à partir de tuyaux d’arrosage jusque-là non recyclés, avec un rendu de toile enduite.
Globalement, les champs créatifs se déploient, s’ouvrent dans toute leur diversité. Dans son étude, Sandrine Pannetier brosse un tableau de ces pans de savoir-faire qui évoluent, se réinventent : c’est vrai à la fois des savoir-faire ancestraux d’un Lesage en broderie qui collabore avec des artistes insufflant une nouvelle énergie, d’un Robert Mercier, créateur et artiste, en mue perpétuelle et qui ne cesse d’explorer de nouvelles directions. C’est vrai de ceux qui, dans le craft, travaillent des matériaux bruts, des gestes et des territoires différents, des artisans qui travaillent avec la technologie, ou encore de cette nouvelle génération de créateurs qui dans la joie, dans l’exigence esthétique, s’attaquent à la question du recyclage en la prenant comme une nouvelle ressource, comme Aurélia Leblanc ou Mathilde Hiron.

handbag ©Mathilde Hiron
Sur des territoires différents, en renouvelant certains gestes, tous redéfinissent en permanence la notion de savoir-faire, dans une approche dynamique et vivante. La science vient à l’appui de leurs démarches.
L’ensemble de la chaîne de valeurs innove
Malgré la crise énergétique, et les remboursements de PGE, les industriels, résiliants, se mobilisent aussi en amont en adaptant leur savoir-faire aux enjeux écologiques et en cultivant leur histoire de territoire, comme la manufacture dentellière Solstiss.

Sur le plan de la pédagogie et de la conservation des gestes par exemple, les outils numériques permettent un archivage plus visuel. La chercheuse Alina Glushkova, travaille ainsi sur un projet européen de conservation de ces gestes en utilisant un système de captation vidéo. Ces outils prendront à l’avenir une importance accrue pour conserver, diffuser les apprentissages. Celle qui est aussi coach dans l’accélérateur de l’IFM sur les créateurs africains, rappelle que l’impératif écologique ne laisse aujourd’hui plus de choix : il faut revoir les modes de production, et parallèlement faire progresser la connaissance de l’envers du décor de la fabrication de vêtement. Pour elle, ce n’est pas un hasard si la biennale d’architecture de Venise s’était donnée pour thème en 2023 : « Afrique, laboratoire du futur ». C’est aussi auprès des savoir-faire de ce continent que sont les éléments de réponse. La prospection se fait en voyant plus loin, à l’échelle internationale.
L’émergence de nouvelles façons de faire est là, la question est désormais de transformer cette aspiration en achats dans un contexte de tension des prix. C’est pourquoi l’information est capitale. Il faut expliquer la valeur des prix appliqués, aux consommateurs, mais aussi des professionnels. Pour cela il ne faut pas hésiter à repenser les formats, à utiliser les outils de la vidéo et les réseaux sociaux pour conférer de l’émotion aux gestes techniques. Il faut aussi retrouver dans les échanges la précision et la richesse du langage de ces savoir-faire, en étant précis sur les matières, les métiers, les gestes.
Le plus important est que les jeunes générations sont déjà à l’écoute, réceptives. Ces gestes, ces nouveaux imaginaires ont déjà imprimé leur rétine et attisé leur curiosité. Sur TikTok, le hashtag Savoir-faire a fait dès son lancement près de 450 millions de vues. Le processus de valorisation est enclenché. Nous sommes au début d’un long chapitre de réinvention.
